2. Les questions litigieuses
Nous étudions ci-dessous chacune des questions litigieuses. Pour cela, nous utiliserons une transcription phonétique très simplifiée, accessible à tous et distincte de celle de l’IPA. Par exemple, le son fricatif chuintant sourd est représenté par [sh] et le son fricatif chuintant sonore est représenté par [j].
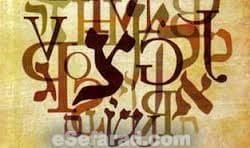
— Transcription du son [k]
Dans la graphie phonétique, la lettre «k» est toujours utilisée. Et cette lettre est devenue une espèce de label d’origine («made in ladino»), à tel point qu’on l’utilise comme une formule magique pour transformer de l’espagnol en un pseudo-judéo-espagnol, sans se poser beaucoup de questions. Mais il est vrai que le son [k] est très fréquent dans les mots d’origines hébraïque, turque, grecque ou balkanique, où il est difficile de le noter «c». De même, en français on utilise pour les mots hébreux la lettre «k» et non la lettre «c».
Aussi, comme indiqué précédemment, nous proposons de conserver la lettre «k» dans tous les mots d’origine orientale, dans toutes les positions. Par contre, pour les mots d’origine latine (espagnol, portugais, français, etc.), on transcrira généralement ce son avec «c» avant «a», «o» et «u», et avec «qu» avant «e» et «i». Exemples : «casha» ; «cultura» ; «cuando» ; «aquel» ; «quedar» ; «quinze» ; «Kipur» ; «ketubah» (contrat de mariage) ; «kapak» (couvercle) ; «kavás» (gardien).
Notons que le Professeur Hassán préconise une solution similaire (écrire selon les cas «c», «qu» ou «k») ; mais son utilisation de la lettre «k» est beaucoup plus restreinte.
— Le son [g] (vélaire sonore, occlusive ou spirante)
Dans la graphie phonétique, la lettre «g» est toujours utilisée. Dans la graphie hispanisante du Professeur Hassán, l’alternance «g» / «gu» (selon la voyelle qui suit) est systématiquement utilisée, et l’on écrira par exemple «guímel».
Les problèmes posés par le son [g] sont proches de ceux du son [k]. Si la double notation «c» / «qu» est adoptée pour noter le son [k] dans les mots d’origine latine, il faut en faire autant pour le son [g]. Celui-ci sera alors noté comme en espagnol, en portugais et en français, «g» avant «a», «o» et «u», et «gu» avant «e» et «i». Exemples : «jugar», «galante», «gayo» (coq), «guerra», «guiador» (guide).
Dans les mots d’origine orientale, la lettre «g» doit bien sûr être utilisée avant «a», «o» et «u». Mais que faire avant «e» et «i» ? Ecrire tout simplement «g» n’est pas possible dans la mesure où cette lettre se prononcera [j] ou [dj] dans cette position (voir plus loin). Ecrire «gu» (selon le choix du Professeur Hassán) nous semble acceptable, car cela correspond aux habitudes graphiques courantes de l’ensemble des langue ibériques et aussi du français. Nous proposons donc cette solution, qui présente aussi l’avantage de fournir une règle unique pour tous les mots possédant le son [g].
Exemples : «gadol» (chef) ; «garida» (crevette) ; «guzmah» (exagération) ; «guemarah» (récit) ; «guerush» (exil, exode) ; «guîmel» (troisième lettre de l’alphabet hébreu) ; «guivir» (notable).
NB : la distinction entre [g] occlusif et [g] spirant, qui n’est pas phonologique, n’a pas à être notée dans une orthographe normalisée. Du reste, personne ne propose de noter cette distinction.
— Le son [ñ] de l’espagnol (consonne nasale palatale)
Dans la graphie phonétique, le son [ñ] est noté avec le digraphe «ny». Dans la graphie du Professeur Hassán, utilisée dans la revue «Sefarad», ce son est noté «ñ», mais aussi «gn», «ni» ou «nj» (chacun de ces digraphes étant surmonté d’un petit arc de cercle pour indiquer qu’il s’agit d’une seule unité phonologique).
Nous estimons que ce son ne doit pas être transcrit avec «ñ», car cela va perturber la diffusion du judéo-espagnol sur Internet et gêner de nombreux imprimeurs qui ne possèdent pas cette lettre. Ecrire «ni» n’est pas non plus une bonne idée, car ce digraphe n’est pas perçu comme une seule unité : on serait tenté de mettre l’accent tonique sur «i» dans «anio» (année), alors qu’il est sur «a». La graphie «gn» serait envisageable, mais ce n’est ni une graphie ibérique, ni une graphie balkanique : elle est essentiellement française et italienne. Par contre, le son [ñ] est transcrit «ny» en catalan, qui est une langue d’Espagne. Aussi, nous proposons «ny» à la place de «ñ». Le choix de «ny» est cohérent avec l’idée de réintégrer le judéo-espagnol dans l’ensemble ibérique. Par ailleurs, c’est aussi le choix du magazine «Aki Yerushalayim».
Exemples : «anyo» (année) ; «Espanya» (Espagne) ; «castanya» (châtaigne) ; «banyo» (bain) ; «nyeve» (neige) ; «nyudo» (nœud) ; «junyo» (juin).
— Les sons [j] et [dj] (chuintantes sonores, fricative et occlusive)
De façon prévisible, dans la graphie phonétique, le son [j] (consonne chuintante sonore fricative, existant aussi en français et portugais) est noté avec la lettre «j», tandis que le son [dj] est noté avec le digraphe «dj».
Dans la graphie du Professeur Hassán, utilisée dans la revue «Sefarad», le son [j] est noté selon les cas : «j» surmonté d’un accent aigu ; «g» surmonté d’un accent aigu ; «y» surmonté d’un accent aigu ; «s» surmonté d’un accent grave ; «z» surmonté d’un accent grave. Dans cette même graphie, le son [dj] est noté selon les cas : «j» surmonté d’un accent circonflexe ; «g» surmonté d’un accent circonflexe ; «y» surmonté d’un accent circonflexe.
Le son [j] apparaît essentiellement en position intervocalique dans des mots d’origine ibérique (exemple : [fija], fille). Dans cette même position intervocalique, on trouve aussi des mots d’origine orientale possédant [dj] (exemple : [badjá], cheminée, lucarne). En position initiale, il y a toujours [dj], dans les mots d’origine ibérique comme dans les mots d’origine orientale (exemples : [djugar], jouer, et [djaba], gratis). Il apparaît que le phonème /j/ du vieil espagnol a conservé sa prononciation [j] en position intervocalique, alors qu’il a évolué vers [dj] en position initiale, en fusionnant avec le phonème /dj/ d’origine orientale. De façon intéressante, la prononciation initiale correspond à celle de l’italien (exemple : [djornal]). D’un point de vue synchronique, nous avons actuellement deux phonèmes /j/ et /dj/ en position intervocalique ; leur opposition est neutralisée en position initiale où nous avons un archiphonème /J/ qui se réalise [dj].
C’est là l’un des problèmes les plus difficiles à résoudre en judéo-espagnol, d’autant plus qu’il faut tenir compte de la prononciation des séquences graphiques «ge» et «gi».
En fait, le problème se pose surtout en position initiale. En position intervocalique, la solution est assez simple. En cette position, il y a d’une part des mots, en majorité d’origine orientale, possédant le son [dj], d’autre part des mots d’origine ibérique possédant le son [j]. En suivant la méthode adoptée précédemment, nous proposons d’utiliser le digraphe «dj» pour noter [dj] en position intervocalique, dans les mots d’origine orientale (exemples : «badjá», cheminée, lucarne, «tulumbadji», pompier, et «madjir», réfugié). Pour noter le son [j], nous proposons d’utiliser la lettre «j» avant «a», «o» et «u», et la lettre «g» avant «e» et «i» (exemples : «ojo», œil, «espejo», miroir, «escoger», choisir, et «legenda», légende). Il existe aussi quelques cas particuliers, de mots d’origine latine possédant [dj] à l’intervocalique, par exemple «lodja» (loge), mot issu à la fois de l’italien «loggia» et de l’anglais «lodge».
En position initiale, comme indiqué ci-dessus, l’opposition entre les phonèmes /j/ et /dj/ est neutralisée, et seul apparaît le son [dj]. Dans la continuité des principes déjà utilisés, la meilleure solution pour noter ce son semble être étymologique. C’est-à-dire que le son [dj] sera noté «dj» dans les mots d’origine orientale, alors que dans les mots d’origine latine il sera noté «j» avant «a», «o» et «u», et «g» avant «e» et «i».
Exemples de mots d’origine orientale : «djaba» (gratis) ; «djadjik» (yaourt épicé) ; «djamdje» (personne, pas âme qui vive) ; «djefá» (refus) ; «djimbriz» (avare) ; «djimbush» (farce, comédie) ; «djuben» (soutane, toge) ; «djustan» (porte-monnaie).
Exemples de mots d’origine latine : «jaqueta» (jaquette) ; «jarro» (jarre, pichet) ; «jonjolî» (sésame) ; «jornal» (journal) ; «joventud» (jeunesse) ; «judîo» (juif) ; «jugar» (jouer) ; «junto» (joint) ; «junyo» (juin) ; «juzgar» (juger) ; «gelata» (glace à manger) ; «genayo» (janvier) ; «gente» (gens) ; «gesso» (plâtre, craie) ; «gigante» (géant) ; «ginoyo» (genou) ; «gimnasio» (lycée) ; «giro» (tour).
La position postnasale se comporte comme la position initiale (cas des séquences phonétiques [ndj]). Nous lui appliquerons donc les mêmes règles. Exemples : «manjar» (manger) ; «lonjano» (lointain) ; «longe» (loin) ; «gengibre» (gingembre).
— Le son [sh] (chuintante fricative sourde)
Dans la graphie phonétique de «Aki Yerushalayim», le digraphe «sh» est toujours utilisé. Dans la graphie du Professeur Hassán, ce son est noté selon les cas : «j» surmonté d’un chevron (accent circonflexe à l’envers) ; «c» surmonté d’un chevron ; «s» surmonté d’un chevron ; etc. Dans de nombreux textes publiés en France, ce son est noté «ch», ce qui est un choix particulièrement malheureux à cause des confusions qu’il peut entraîner.
Ce son est très important en judéo-espagnol et provient de mots aussi bien ibériques que turcs ou hébreux. De plus, le son «sh» est présent dans de nombreuses autres langues étrangères pratiquées par les locuteurs de judéo-espagnol (français, anglais, italien, etc.). Le choix de «x» comme en portugais, en catalan ou en vieil espagnol risquerait d’être assez mal compris. Cet «x» serait automatiquement interprété comme représentant les sons [ks] ou [gz] (par exemple, «baxo» risquerait d’être lu [bakso]). Aussi nous ne retenons pas cette solution. En revanche, la graphie «sh» déjà utilisée dans «Aki Yerushalayim» est très pratique et ne présente aucune ambiguïté. Nous proposons donc de la conserver.
Exemples : «basho» (sous) ; «bushcar» (chercher) ; «pásharo» (oiseau) ; «casha» (caisse, boîte) ; «brusha» (sorcière) ; «peshe» (poisson) ; «sesh» (six) ; «shastre» (tailleur) ; «shena» (scène) ; «shaká» (plaisanterie) ; «shavon» (savon).
— Le son [ch] (chuintante occlusive sourde : «ch» de l’espagnol et de l’anglais)
Pour noter ce son, la graphie phonétique de «Aki Yerushalayim» utilise le digraphe «ch». La graphie du Professeur Hassán utilise soit «ch», soit la lettre «c» surmontée d’un accent circonflexe. On trouve aussi en France la graphie «tch», que l’on ne peut que rejeter, car elle place ipso-facto le judéo-espagnol dans une situation de subordination par rapport au français (et non pas dans une situation de langue autonome).
Il nous semble évident, en l’occurrence, que c’est le digraphe «ch» qui doit être retenu, d’autant que cela correspond à la pratique de l’espagnol officiel.
Exemples : «chupar» (sucer) ; «cacha» (chasse) ; «noche» (nuit) ; «socho» (associé) ; «pecha» (impôt, contribution) ; «chapeo» (chapeau) ; «chirak» (apprenti, disciple) ; «chorbá» (soupe au riz).
— Les sons [z] et [s] en positions initiale et intervocalique
La solution purement phonétique adoptée par «Aki Yerushalayim» a le tort de rompre le lien avec les langues ibériques (de même qu’avec les autres langues romanes).
La solution «hispanisante» de Iacob Hassán consiste à noter le son [z] (n’existant pas en castillan) avec un accent aigu ajouté sur les lettres «c», «s» ou «z» selon que l’une ou l’autre est utilisée dans l’orthographe officielle de l’espagnol. En ce qui concerne [s], Iacob Hassán ne donne aucune indication théorique, ce qui signifie qu’il note ce son avec les lettres «c», «z» ou «s», selon ce qui existe dans l’orthographe officielle de l’espagnol.
Il serait intéressant qu’un locuteur de judéo-espagnol puisse passer facilement à l’espagnol et au portugais, et vice-versa : ici figure l’un des éléments essentiels pour la réintégration du judéo-espagnol dans l’ensemble ibérique. Or, comme indiqué précédemment, la graphie utilisée en portugais moderne (et qui existait aussi en vieil espagnol) correspond tout à fait à ce qu’il faut. C’est donc celle que nous proposons ci-dessous[1].
— Le son [z] sera transcrit «z» en position initiale. En position intervocalique, il sera transcrit «s» s’il correspond à la lettre espagnole «s», et il sera transcrit «z» s’il correspond aux lettres espagnoles «z» ou «c». Ainsi, les occurrences de la lettre «z» seront similaires à ce qui existe en portugais. Dans les mots d’origines hébraïque, turque, grecque ou balkanique, on utilisera «z» dans toutes les positions.
Exemples : «zelo» (zèle) ; «casa» (maison) ; «queso» (fromage) ; «vizino» (voisin) ; «fazer» (faire) ; «Zohar» (Zohar) ; «ziyara» (pèlerinage sur une tombe).
— Le son [s] sera transcrit selon les cas «s», «ss», «c» ou «ç». En position initiale, il sera transcrit : «s» s’il y a «s» en espagnol ; «c» s’il y a «c» en espagnol ; «ç» s’il y a «z» en espagnol. En position intervocalique, il sera transcrit : «ss» s’il y a «s» en espagnol ; «c» s’il y a «c» en espagnol ; «ç» s’il y a «z» en espagnol. Comme il a déjà été indiqué, les occurrences de «s», «ss», «c» et «ç» seront ainsi similaires à ce qui existe en portugais.
Dans les mots ayant une origine orientale, mais non-hébraïque, on utilisera «s» en position initiale et «ss» en position intervocalique (exemple : kassavet). Dans les mots d’origine hébraïque, on utilisera «s» en position initiale et «ss» en position intervocalique si le son [s] correspond aux lettres «shin» ou «samekh» (exemples : «sivah» et «nissán»), et l’alternance «c / ç» s’il correspond à la lettre «tsadi» (exemples : cedakah, maçah). Pour ce dernier cas, on se reportera plus loin au paragraphe consacré à la lettre «tsadi».
Exemples : «silencioso» (silencieux) ; «sovre» (sur) ; «salud» (santé) ; «cercle» (cercle, club) ; «cesto» (panier) ; «cevoya» (oignon) ; «civdad» (ville) ; «çapato» (chaussure) ; «çumo» (jus) ; «consejo» (conseil, avis) ; «bassina» (bassine) ; «passar» (passer) ; «gracia» (grâce) ; «concilio» (conseil, assemblée) ; «braço» (bras) ; «caveça» (tête) ; «fuerça» (force) ; «empeçar» (commencer) ; «moço» (domestique) ; «safek» (doute, soupçon) ; «sirma» (fil d’or) ; «sivah» (deuil de sept jours) ; «Sinay» (Sinaï) ; «kassavet» (mélancolie) ; «mossafir» (hôte, visiteur) ; «yassak» (halte ! stop !) ; «nissán» (7e mois juif) ; «Pessakh» (Pâque) ; «khassid» (pieux) ; «cedakah» (aumône, charité, bienfaisance) ; «cibur» (communauté) ; «çavah» (testament, dernière volonté) ; «maçah» (pain azyme, matsa) ; «çadik» (juste) ; «miçvah» (bonne action).
NB : Non seulement la lettre «ç» existe sur les claviers français, portugais et turc, mais elle existe aussi sur les claviers espagnols vu que le catalan (qui possède cette lettre) est l’une des langues officielles de l’Espagne. La lettre «ç» ne pose donc aucun problème d’impression.
— La lettre «c»
Il découle de tout ce qui précède que la lettre «c» aura comme en espagnol, en portugais, en catalan, en français et en anglais une double valeur : [k] avant «a», «o» et «u» ; [s] avant «e» et «i».
Une autre raison vient plaider pour le maintien de la lettre «c» et de son non-remplacement par «k» ou «s». C’est l’existence des sigles où cette lettre est une des plus fréquentes qui soit. Exemples : Unesco, CD-Rom, CEE, CEI, CIA, CRIJ, CNRS, PC, Cobol, etc. Qu’on le veuille ou non, dans un texte moderne, la lettre «c» réapparaîtra toujours, à un moment ou un autre !
— Les sons [z] et [s] en position finale
En position finale, il est difficile de trouver une règle systématique de correspondance entre l’espagnol, le portugais et le judéo-espagnol. Aussi en cette position, il nous semble plus simple d’adopter une solution à la fois phonétique et dérivationnelle. C’est-à-dire : écrire «z» si on prononce [z] et si la dérivation se fait avec [z], et écrire «s» si on prononce [s] et si la dérivation se fait avec [s].
Exemples : «albanez» (albanais – en espagnol, albanés), «albaneza» (albanaise) ; «arroz» (riz – esp. arroz), «arrozal» (rizière) ; «boz» (voix – esp. voz), «bozarrón» (grosse voix) ; «burguez» (bourgeois – esp. burgués), «burguezîa» (bourgeoisie) ; «diez» (dix – esp. diez), «diezén» (dixième) ; «luz» (lumière – esp. luz), «luzir» (briller) ; «mez» (mois – esp. mes), «mezada» (mensualité) ; «muez» (noix – esp. nuez), «muezezal» (noyer) ; «nariz» (nez – esp. nariz), «narizes» (narines) ; «paez» (pays – esp. país, ital. paese) ; «paz» (paix – esp. paz), «paziguoso» (pacifique) ; «raiz» (racine – esp. raíz) ; «vez» (fois – esp. vez), «dos vezes» (deux fois) ; «antes» (avant – esp. antes) ; «compás» (compas – esp. compás), «compassamiento» (vie trop bien réglée) ; «mas» (plus – esp. más) ; «tres» (trois – esp. tres), «tresser» (troisième) ; «kenaz» (amende, indemnité – mot hébreu) ; «kavás» (garde, gardien – mot turc).
— La lettre hébraïque «tsadi»
Cette lettre se prononce en hébreu [ts]. Néanmoins, en judéo-espagnol, sa prononciation s’est transformée en [s]. En cela, son évolution est identique à celle de l’ancien phonème espagnol /ts/ (orthographié «c» ou «ç») dont la prononciation est aussi devenue [s] (voir ci-dessus).
Aussi, afin de permettre une correspondance facile avec l’hébreu, nous proposons de noter le son [s] avec l’alternance «c / ç» lorsqu’il correspond au «tsadi» de l’hébreu. L’orthographe proposée ici permet donc une ouverture sur l’hébreu et pas seulement sur les langues ibériques. Par ailleurs, la notation «c / ç» convient aussi très bien pour les mots dans lesquels le son [s] correspond à la lettre arabe «sâd» (s emphatique), d’autant que le «tsadi» hébreu et le «sâd» arabe remonte à une même origine historique.
Exemples : «cedakah» (aumône, charité, bienfaisance) ; «cibur» (communauté) ; «çavah» (testament, dernière volonté) ; «maçah» (pain azyme, matsa) ; «çadik» (juste) ; «miçvah» (bonne action).
— Le «h» étymologique
Pour résoudre cette question, il faut se rappeler que l’objectif est de réintégrer le judéo-espagnol dans l’ensemble des langues ibériques, et de faciliter le passage vers d’autres langues (par exemple, le français). Dans cette perspective, la lettre «h» sera rétablie. De même, il est possible d’utiliser «h» dans les mots d’origine hébraïque pour noter la lettre «hey». En effet, même si cette consonne étymologique n’est pas prononcée en judéo-espagnol, elle est notée dans la plupart des translittérations de l’hébreu.
Exemples : «habitante» (habitant) ; «herencia» (héritage) ; «hombre» (homme) ; «honor» (honneur) ; «hora» (heure) ; «hallel» (variété de psaume) ; «hasser» (moins, néanmoins) ; «Zohar» (Zohar) ; «guzmah» (exagération), «guemarah» (récit) ; «çavah» (testament, dernière volonté) ; «cedakah» (aumône, charité, bienfaisance) ; yeshivah (yéshiva).
Dans les mots d’origine hébraïque, un avantage du rétablissement de «h» en position finale et de faire porter correctement l’accent tonique sur la dernière syllabe (et non sur l’avant-dernière). Il faut noter, par ailleurs, que dans la transcription de «Aki Yerushalayim», la lettre hébraïque «hey» en position initiale est souvent notée » ‘h» («h» précédée d’une apostrophe), alors qu’elle tend à disparaître dans la prononciation courante. Dans ce cas particulier, la graphie de «Aki Yerushalayim» semble plutôt judéo-arabe que judéo-espagnole ; mais la notation «h» (sans apostrophe) permet de répondre à toutes les préoccupations.
Tout ceci implique que la lettre «h» ne pourra pas être utilisée pour noter la consonne fricative uvulaire sourde (ch allemand, jota espagnole). Pour noter ce son, on utilisera le digraphe «kh» (voir plus bas).
— Choix entre «f» et «h»
La graphie utilisée par «Aki Yerushalayim» a tendance à utiliser des formes sans [f] (exemple «ijo» et non pas «fijo», fils). Cela provient de ce qu’elle est surtout basée sur les formes d’Istanbul, plus proches du castillan. Cependant, dans les parlers judéo-espagnols des Balkans et de Salonique, ce sont les formes avec [f] qui étaient préférées. Pour notre part, nous proposons de privilégier les formes avec «f», afin de rendre la langue compréhensible au public le plus vaste possible (dans les pays de langue espagnole, comme dans ceux de langue portugaise et italienne) et de mieux marquer la personnalité du judéo-espagnol (dont l’origine est ibérique au sens large et non purement castillane). Exemples : «fija» et non «ija» (fille) ; «favlar» et non «avlar» (parler).
De même, dans le cadre de la standardisation littéraire on préférera : «fuego» et non «khuego» (feu) ; «fuente» et non «khuente» (fontaine) ; «fuerça» et non «khuerça» (force).
— Choix entre «ll» et «y»
De façon prévisible, dans la graphie phonétique, la lettre «y» est systématiquement utilisée pour noter le son [y]. Dans la graphie du Professeur Hassán, différentes formules étymologiques sont utilisées, notamment le digraphe «ll» (parfois accompagné d’un arc de cercle souscrit indiquant qu’il s’agit d’un son unique).
Le son [y] est très fréquent en judéo-espagnol. Il apparaît souvent dans des mots d’origine ibérique. Par rapport à l’espagnol, il correspond alors soit à «y» (ex. «mayo», mois de mai), soit à «ll» (ex. «gallo», coq). De plus, le son [y] figure dans de nombreux mots issus de l’hébreu ou du turc.
Pour rapprocher la graphie du judéo-espagnol de celle des autres langues ibériques, on pourrait proposer d’utiliser le digraphe «ll» dans les mêmes cas qu’en espagnol (d’autant qu’il y une tendance dans le monde hispanophone à ce que le digraphe «ll» se prononce [y] et non plus [ly]). Cependant, il existe en judéo-espagnol un certain nombre de mots possédant la suite géminée [ll] au niveau phonétique. Exemples : «Bella» (nom propre de femme) ; «bulluk» (foule) ; «canella» (cannelle) ; «catinella» (cuvette) ; «djellat» (bourreau) ; «gabella» (gabelle) ; «gallakh» (prêtre chrétien) ; «hallel» (variété de psaume) ; «jallo», jaune ; «mallakh» (ange) ; «mallah» (quartier) ; «millet» (nation, peuple) ; «tellek» (garçon de bain) ; «villa» (villa) ; «yullé» (torpille, obus) ; «zullam» (ruiné).
Aussi, la séquence graphique «ll» doit être réservée à la notation de la séquence phonique [ll]. Et la seule solution possible est d’utiliser la lettre «y» pour noter le son [y], quelle que soit la langue d’origine.
Exemples : «caye» (rue) ; «eyos» (eux) ; «famiya» (famille) ; «gayo» (coq) ; «ginoyo» (genou) ; «mayor» (majeur, maire) ; «yamar» (appeler) ; «yegar» (arriver) ; yeshivah (école rabbinique) ; yenicherî (janissaire) ; «yo» (moi) ; «yullé» (torpille, obus).
Par ailleurs, à cause d’évolutions phoniques spécifiques, quelques autres termes d’origine ibérique contiendront la lettre «y» (exemple : «yelar» et non «*gelar» ou «*helar», geler) et quelques termes possédant «ll» en espagnol n’auront pas «y» en judéo-espagnol (exemple : «luvia» et non «*yuvia», pluie).
— Le son [kh] (fricative uvulaire sourde : ch dur allemand, jota espagnole)
Dans la graphie phonétique de «Aki Yerushalayim», c’est la lettre «h» qui est utilisée pour noter [kh]. Dans la graphie du Professeur Hassán, ce son est noté avec soit la lettre «h» accompagnée d’un point souscrit, soit la lettre «c» accompagnée d’un tiret souscrit ou soit la lettre «j» (jota espagnole).
Ce son est assez fréquent dans des mots venant du grec, du turc et de l’hébreu (notamment pour exprimer la lettre «khet», ainsi que la lettre «kaf» lorsque sa prononciation est fricative). Nous ne retiendrons pas la notation «h» car cette lettre sert généralement à noter non pas une fricative uvulaire ou vélaire, mais une fricative glottale. Il est probable que les rédacteurs de «Aki Yerushalayim» aient été influencés dans leur choix par la vieille translittération livresque de l’hébreu en français qui notait la lettre «khet» avec «h», sans respect pour sa prononciation réelle. Il faut ajouter que nous utilisons déjà la lettre «h» pour noter les «h» étymologiques d’origines latine ou hébraïque (venant de la lettre «hey» dans ce dernier cas).
Aussi, la transcription avec «kh» paraît à la fois la plus simple et la plus exacte. Exemples : Khanukah (Hanouka) ; kharem (harem) ; Khayim (Haïm) ; khaber (information, nouvelle) ; khak (justice, droit) ; khakham (rabbin) ; khaviar (caviar) ; kholera (choléra) ; khristunya (Noël, naissance du Christ).
— Le système accentuel
L’accent tonique peut tomber en judéo-espagnol sur des endroits différents selon l’origine du mot (espagnol, turc, hébreu, etc.). Nous suggérons donc de noter cet accent tonique lorsque la graphie ne permet pas de le prévoir. Pour cela, le système de l’espagnol littéraire moderne paraît parfaitement adapté, et nous suggérons de l’adopter (les accents toniques irréguliers sont notés avec un accent aigu).
La seule différence porterait sur la notation de l’accent tonique sur » i «. En effet, dans une écriture manuscrite, le i normal ne se distingue pratiquement pas du í accentué. Pour ce dernier, nous proposons donc la graphie » î » (i surmonté d’un accent circonflexe) ou » Ï » (i surmonté d’un tréma). Par ailleurs, l’utilisation du «h» en final pour noter la lettre hey de l’hébreu permet de réduire le nombre d’accents graphiques (voir ci-dessus).
Enfin, vu que dans l’avenir il n’y aura pratiquement plus de locuteurs pour lesquels le judéo-espagnol sera la principale langue d’usage, il est important de noter les accents toniques irréguliers dans l’orthographe, afin de conserver une prononciation fidèle de la langue. Ce choix est analogue à la notation des points-voyelles qui furent jadis introduits en hébreu, lorsque cette langue cessa d’être couramment parlée.
— L’orthographe grammaticale
Comme dans toutes les langues écrites, il sera nécessaire d’effectuer une normalisation des mots grammaticaux (conjonctions, prépositions, etc.) et de la morphologie (notamment les terminaisons des verbes). L’orthographe grammaticale n’a pas besoin d’être strictement phonétique, mais elle doit être régulière, cohérente et précise. Ce thème ne sera pas abordé dans cet article. Nous nous contenterons de signaler ici que dans quelques cas la solution la plus pratique sera de conserver la forme graphique utilisée en espagnol officiel. Par exemple, la conjonction «y» (et) de l’espagnol pourrait être conservée telle quelle et elle ne serait pas remplacée par «i» ; cela afin de conserver les habitudes visuelles de lecture.
[1]. Pour mieux comprendre la cohérence générale des propositions qui suivent, on pourra se reporter à l’Annexe 1 qui présente des listes comparées de mots en judéo-espagnol, espagnol, portugais et italien.
—————————————————
Référence exacte de la version initiale de cet article (pour toute citation): Gérard GALTIER, «Pour une orthographe méditerranéenne du judéo-espagnol», in Rena MOLHO (dir.), Proceedings of the 3rd International Conference on the Judeo-Spanish Language (Social and Cultural Life in Salonika through Judeo-Spanish Texts) [October 17 & 18, 2004], Fondation Ets Ahaim, Salonique, 2008, 238 p., pp. 217-235.

Docteur en linguistique, spécialiste des questions de graphie et de standardisation Institut des Sciences de la Communication du CNRS
 eSefarad Noticias del Mundo Sefaradi
eSefarad Noticias del Mundo Sefaradi

