Actuellement, deux transcriptions principales en caractères latins existent pour le judéo-espagnol[1]. Il y a d’une part la graphie hispanisante utilisée par l’école espagnole du regretté Professeur Iacob Hassán. Cette transcription provient du désir de noter à la fois la prononciation exacte du judéo-espagnol et sa parenté avec le castillan moderne. Il y a d’autre part la graphie phonétique, qui a été adoptée par la majorité des utilisateurs. Cette seconde transcription trouve son origine dans l’adaptation au judéo-espagnol de la graphie latine turque (imposée par Mustafa Kemal Atatürk). La graphie phonétique connaît différentes variantes : celle utilisée en Turquie (on y conserve le code graphique du turc, dans lequel la consonne chuintante sourde se transcrit «s» avec cédille) ; celle utilisée en France (la consonne chuintante sourde y est le plus souvent transcrite «ch») ; celle du magazine «Aki Yerushalayim» dirigé par Moshe Shaul, qui est la plus généralement utilisée et que l’on retrouve aussi dans la majorité des sites Internet (la consonne chuintante sourde y est transcrite «sh»).
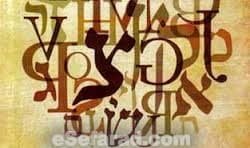
La graphie hispanisante répond aux besoins scientifiques de ses créateurs, qui peuvent disposer des facilités d’un service d’édition très performant. Mais elle n’a été adoptée par aucune autre publication que la revue universitaire «Sefarad» publiée à Madrid, et elle n’est jamais employée sur Internet. La raison de ce rejet est essentiellement pratique : cette graphie utilise un nombre très important d’accents que la plupart des personnes ne possèdent pas sur leurs claviers ; de plus, sur Internet et dans les emails, l’utilisation de ces accents entraîne des modifications de lettres qui rendent les textes illisibles. En outre, cette graphie est basée sur des choix parfois discutables : elle est conçue comme si le judéo-espagnol était une sorte de dialecte du castillan moderne, en occultant ses rapports avec les autres langues de la péninsule ibérique ; elle se base sur l’orthographe moderne de l’espagnol pour faciliter la lecture des textes aux non-spécialistes, alors que la revue «Sefarad» est une publication destinée à des universitaires qui n’ont pas besoin d’un tel artifice ; cette graphie ne tient pas compte du fait que le judéo-espagnol est largement utilisé dans des pays non hispanophones ; la prononciation des mots est souvent indiquée par les accents et non par les lettres elles-mêmes, ce qui est très étrange pour le lecteur.
Il est vrai que la majorité des utilisateurs a choisi la graphie phonétique pour des raisons de commodité pratique. L’on pourrait donc supposer que le problème est résolu et que l’on n’a pas à le remettre sur le tapis. Cependant, cette graphie présente aussi des défauts : elle tend à isoler le judéo-espagnol des autres langues romanes, et à accélérer son «agonie», comme dirait Haïm Vidal Sephiha ; elle ne lui permet pas de s’appuyer sur l’extension mondiale de langues apparentées telles que l’espagnol et le portugais, et de profiter de la vitalité des communautés juives d’Amérique latine.
La graphie phonétique est très marquée par le contexte historique et idéologique dans lequel elle est apparue. Lorsqu’elle fut créée, l’idée de base était d’intégrer la communauté juive dans la nouvelle Turquie, raison pour laquelle le système orthographique choisi fut assez proche de celui du turc. Cette même transcription (quelque peu modifiée et améliorée) a continué à être utilisée en Israël car elle correspondait mieux à la perspective sioniste qu’une graphie plus «latine». Mais, ce faisant, elle gâche l’une des qualités essentielles du judéo-espagnol, qui était de permettre une ouverture sur les principales langues occidentales.
En outre, la graphie hispanisante et la graphie phonétique ont un défaut commun, c’est qu’elles privilégient l’une et l’autre le passé, sans offrir une vision prospective du futur de la langue. La graphie hispanisante du Professeur Hassán est essentiellement adaptée à des travaux d’ordre philologique ; quant à la graphie phonétique, elle est surtout utilisée pour transcrire les souvenirs lointains de ceux dont la langue maternelle fut le judéo-espagnol. Si l’on veut que la transcription de cette langue contribue à son renouveau, il faut concevoir une orthographe moderne qui soit à la fois unifiée internationalement et ouverte sur l’ensemble des langues avec lesquelles la communauté est en contact. Comme nous allons le voir, une telle orthographe jaillit spontanément si l’on considère le judéo-espagnol comme une langue «méditerranéenne» au sens large, en tenant compte de l’ensemble de ses sources : à la fois les diverses langues de la péninsule ibérique et certaines langues «orientales» telles que le turc et l’hébreu.
Il est clair qu’on ne peut pas purement et simplement adopter (ou adapter) l’espagnol moderne pour développer un usage littéraire du judéo-espagnol, en partant de l’hypothèse qu’il s’agirait de la même langue. Une telle méthode serait en réalité une traduction, similaire par exemple à la traduction d’un texte galicien en castillan. Un texte espagnol saupoudré de quelques mots hébreux, turcs, grecs, italiens et français n’est pas du judéo-espagnol : cela reste du castillan.
Si l’on veut à la fois profiter de la force et de l’extension de l’ensemble des langues latines, et maintenir le judéo-espagnol dans sa spécificité, on ne doit pas le noyer dans la langue castillane, mais on doit le reconnaître comme une langue ibérique à part entière. Ceci lui permettra de devenir une langue culturelle pour l’ensemble des communautés juives d’Amérique latine (au Brésil et à Curaçao comme dans les pays hispanophones) et de participer en même temps au grand mouvement de renaissance des langues régionales d’Espagne (galicien, catalan, léonais, etc.). Et tout cela viendra renforcer le judéo-espagnol dans les pays où il est encore couramment pratiqué (notamment Turquie et Israël) et dans ceux où se manifeste la volonté de le maintenir (USA, France, Grèce, etc.).
Un tel judéo-espagnol rénové pourrait notamment être utilisé dans toutes les rencontres entre communautés de différentes langues latines (portugais, espagnol, italien, français…). Il servirait en particulier pour les chansons, les pièces de théâtre, les contes et certains rituels.
1. Quelques principes généraux[2].
— Le mouvement de renaissance moderne du judéo-espagnol est largement parti de la Turquie ou de communautés juives venues de Turquie. Ce faisant, on a souvent négligé les communautés des Balkans (Bulgarie, ex-Yougoslavie, etc.) et celle de Salonique. Or, il ne faut pas oublier qu’à l’époque de l’Empire Ottoman, la plus vaste communauté juive se trouvait à Salonique, et qu’il s’agissait là de la seule grande ville où le judéo-espagnol était la langue commune de la population, quelle que soit la religion d’origine. Par ailleurs, le judéo-espagnol de Salonique est en quelque sorte intermédiaire entre les parlers des Balkans et ceux de Turquie. Dans la suite de cet article, nous ferons donc largement référence au judéo-espagnol de Salonique, et pour cela nous nous baserons sur le dictionnaire de Joseph Nehama.
— Pour la notation de la majorité des sons, aucun problème ne se pose. Il s’agit notamment des sons [a], [e], [i], [o], [u], [b], [d], [f], [l], [m], [n], [p], [r], [t] et [v] que l’on note respectivement avec les lettres «a», «e», «i», «o», «u», «b», «d», «f», «l», «m», «n», «p», «r», «t» et «v». Cependant des difficultés apparaissent pour la notation de sons tels que [s], [z], [k], [dj], etc. Ce sont à ces problèmes que nous essayerons plus bas d’apporter une solution.
— La première grande difficulté de transcription est que certains phonèmes du vieil espagnol n’ont pas évolué de la même manière en judéo-espagnol et en castillan moderne. C’est par exemple le cas de quatre phonèmes anciens : /s/, /z/, /ts/ et /dz/. En judéo-espagnol, les deux phonèmes /s/ et /ts/ ont fusionné dans le son dental sourd [s], et les deux phonèmes /z/ et /dz/ ont fusionné dans le son dental sonore [z]. En castillan moderne, /s/ et /z/ ont fusionné dans un même son alvéolaire sourd (orthographié «s» dans tous les cas), tandis que /ts/ et dz/ ont fusionné dans un même son interdental sourd (orthographié «c» ou «z» selon la voyelle qui suit). C’est ainsi que les quatre mots prononcés en judéo-espagnol [pasar], [kaza], [braso] et [azeyte] correspondent respectivement à «pasar», «casa», «brazo» et «aceite» en espagnol moderne. Or il se trouve que l’évolution du judéo-espagnol correspond à celle du portugais et de certaines langues régionales d’Espagne. En l’occurrence, l’orthographe portugaise permet de résoudre le problème et de fournir au judéo-espagnol une graphie moderne qui ouvre des portes aussi bien vers le castillan que vers le portugais et le catalan. Pour ces quatre mots, nous proposons donc les transcriptions suivantes : «passar», «casa», «braço» et «azeite». Par ailleurs, ces notations correspondent à des usages courants dans les textes écrits en vieil espagnol. Enfin, comme nous le verrons plus loin, une évolution similaire s’est produite pour le «tsadi» hébreu qui est passé au son [s] en judéo-espagnol. Pour la notation de ce son, nous appliquerons la même règle que pour le mot «braço» ci-dessus, et nous écrirons par exemple «maçah» (pain azyme, matsa).
— La seconde grande difficulté est que le judéo-espagnol a intégré de nombreux mots d’origine non ibérique (hébreu, turc, grec, etc.). On peut ainsi y opposer un ensemble de termes d’origine latine et un ensemble de termes d’origine «orientale». Ici le problème se pose notamment pour la notation du son [k]. La notation «k» convient parfaitement à tous les mots d’origine orientale (exemples : «kal», synagogue, ou «Kipur»). Cependant, elle habille les termes d’origine latine d’un aspect étrange, même si cela correspond au choix du magazine «Aki Yerushalayim». Quant à la double notation «c» / «qu», qui est celle de l’espagnol, du portugais et de la majorité des langues romanes, elle convient bien aux mots d’origine latine (exemples : «caveça», tête, ou «quedar», rester), mais elle est inapplicable pour les termes d’origine orientale à cause des habitudes visuelles. La solution que nous proposons ci-dessous est d’adopter deux transcriptions différentes selon l’origine : «k» pour les termes d’origine orientale ; «c» / «qu» pour les termes d’origine latine. Du reste, des différenciations similaires existent dans de nombreuses langues : par exemple, en français, le son [f] est noté «ph» dans les mots issus du grec.
— Il faut tenir compte du fait que de nombreux mots modernes possèdent des images graphiques qui sont identiques dans la plupart des langues. Vu que cela correspond aux habitudes des usagers et que la communauté séfarade est dispersée dans le monde entier, il convient de garder ces images graphiques. Exemple : «kimonó».
— L’orthographe proposée doit avoir un caractère réellement international et doit pouvoir être utilisée aussi bien en Amérique du Nord ou du Sud qu’en Europe ou au Proche-Orient. A ce propos, il est regrettable que la variété de la transcription phonétique qui est généralement utilisée en France tend à priver le judéo-espagnol de ses potentialités internationales. Par exemple, dans cette transcription, les mots caisse et nuit s’écrivent «kacha» et «notche», ce qui est difficilement acceptable lorsque l’on s’éloigne des frontières de la France.
— Comme nous l’a signalé M. Manuel Lobo (philologue, d’origine catalane, spécialiste de l’histoire des langues romanes), les propositions que nous faisons dans cette article sont proches de celles du Professeur Raymond Foulché-Delbosc (qui était directeur de la «Revue hispanique» autour de 1900). Ce dernier suggérait de se baser sur la graphie du vieil espagnol qu’il jugeait la mieux adaptée pour noter le judéo-espagnol moderne. Nous nous écartons, cependant, des propositions de R. Foulché-Delbosc en ce que nous estimons que le digraphe «sh» doit être préféré à la lettre «x» pour noter la consonne chuintante sourde (vu qu’il faut tenir compte de la présence de nombreux mots d’origine turque ou hébraïque). Par exemple, nous proposons d’écrire «casha» (caisse) et non «caxa» comme en vieil espagnol (ce terme s’écrit «caja» en espagnol moderne).
— Si le judéo-espagnol survit dans le futur, ce ne sera plus comme une langue maternelle ou comme la première langue d’une communauté ; mais ce sera comme une deuxième ou une troisième langue, qui sera apprise dans le cadre de l’enseignement scolaire ou d’associations culturelles, ou par la lecture individuelle. Il sera alors intéressant que les choix graphiques puissent fournir aussi certaines informations d’ordre sociologique ou historique. Il est probable que le judéo-espagnol restera essentiellement utilisé sur des sites Internet, dans la presse périodique, dans des recueils de contes, dans des chansons, dans des pièces de théâtre et dans certains rituels religieux. Il convient donc que l’on sorte du bricolage actuel qui consiste à transcrire chacun à sa façon et tant bien que mal un usage oral varié, et que la langue soit standardisée de façon sérieuse dans son usage écrit. Cela est une condition indispensable pour que le judéo-espagnol puisse être enseigné aux nouvelles générations.
[1]. Nous conseillons aux lecteurs non spécialisés en linguistique de «commencer par la fin» et de lire l’Annexe 2 (conte traditionnel) et l’Annexe 3 (texte moderne), avant de passer à la suite de cet article. Ainsi, ils se feront une idée concrète de nos propositions et ils n’auront aucune difficulté à comprendre le détail de nos explications.
[2]. Comme on le sait, la tendance actuelle est d’employer le mot «ladino» pour désigner le judéo-espagnol parlé, alors que dans l’ancienne Espagne ce terme désignait la traduction mot à mot, en langue vernaculaire, de textes religieux hébreux. Le terme “judéo-espagnol” est une appellation scientifique moderne, tandis que les locuteurs des communautés de l’Empire ottoman utilisaient des termes tels que «djudezmo», «spanyolit», «espanyolico», etc. Cependant, nous n’étudierons pas la question du nom de la langue dans le cadre de cet article.
—————————————————
Référence exacte de la version initiale de cet article (pour toute citation): Gérard GALTIER, «Pour une orthographe méditerranéenne du judéo-espagnol», in Rena MOLHO (dir.), Proceedings of the 3rd International Conference on the Judeo-Spanish Language (Social and Cultural Life in Salonika through Judeo-Spanish Texts) [October 17 & 18, 2004], Fondation Ets Ahaim, Salonique, 2008, 238 p., pp. 217-235.

Docteur en linguistique, spécialiste des questions de graphie et de standardisation Institut des Sciences de la Communication du CNRS
 eSefarad Noticias del Mundo Sefaradi
eSefarad Noticias del Mundo Sefaradi


En galicien, la lettre «x» (exemple: «caixa») est consonne chuintante sourde.